- Sommaire archives
- Revue 131. 2H AVEC SERGE DUTFOY
- Revue 130. DESSEIN D'ESSONNE
- Revue 129. LITTERATUBE
- Revue 128. Un détail
- Revue 127. Prefigurations 20 ans
- Revue 126. Cinépeinture
- Revue 125. Une autre histoire des idees
- Revue 124. RESIDENCE DESSEIN D'ESSONNE
- Revue 123. MA BOITE VERTE 4
- Revue 122. HISTOIRE DE LA PHOTO PAR SA CIRCULATION
- Revue 121. SENAUD RESIDENCE SENART
- Revue 120. BON. Après le livre
- Revue 119. 2H avec Jacques Doillon
- Revue 118. Promesses 360
- Revue 117. Ma boite verte3
- Revue 116. Conteurs de ville
- Revue 115. Rapports animaux
- Revue 114. Héros populaire
- Revue 113. Pop philosophie
- Revue 112. Peinture figurative contemporaine
- Revue 111.Effets spéciaux sans faux-semblant
- Revue 110. 2H avec BOUCHAIN
- Revue 109. Cinetourisme
- Revue 108. Cultures et mobilité2
- Revue 107. Cultures et mobilité
- Revue 106. Enseigner le jeu vidéo
- Revue 105. 8h avec Francois BON
- Revue 104. Ma 2e boite verte
- Revue 103. Femmes empêchées
- Revue 102. Villecinéma
- Revue 101. 2H avec Alexis BLANCHET
- Revue 100. POP CULTURES
- Revue 98. NOUVEAUX TALENTS DE LA BD
- Revue 97. UN NOUVEAU JOURNALISME
- Revue 96.PROJETS SITUES
- Revue 95. ELLES REGARDENT LE MONDE
- Revue 94. MA BOITE VERTE
- Revue 93. UN THEATRE DANS LA VILLE
- Revue 92. INTERNET ALL OVER
- Revue 91. AGITATIONS
- Revue 90. ARTEFACTS
- Revue 89. BERLIN SOUCHE
- Revue 88. ROCK CULTURE
- Revue 87. CAMERA SILENS
- Revue 86. LE BIEN CONNU
- Revue 85. GRAFFITIS PATRIMOINE
- Revue 84. LUMIERES
- Revue 83. VILLE OBSESSIONNELLE
- Revue 82. PATAUT VALET DE TREFLE
- Revue 81. STREET ART, ART A PART ?
- Revue 80. HORIZON VERTICAL. MF PLISSART.
- Revue 79. ILLUSTRE ET INCONNU
- Revue 78. DEVENIR CULTE
- Revue 77. EVENEMENT
- Revue 76. CARTOGRAPHIER
- Revue 75. PEETERS
- Revue 74. AUTEUR
- Revue 73. La Danza de la Realidad. JODOROWSKY
- Revue 72. Homme machine
- Revue 71. Grandir avec la ville
- Revue 70. Marcher dans la ville
- Revue 69. Chairs
- Revue 68. Labyrinthes
- Revue 67. 2h avec Christian Jaccard
- Revue 66. Mimi cracra
- Revue 65. Carnets d'exils
- Revue 64. finir les années 80 ?
- Revue 63. Une soirée avec TAVERNIER
- Revue 62. Où est la rue?
- Revue 61. Devenir un super-héros
- Revue 60. Japon pays imaginé.
- Revue 59. Un artiste en bas de chez moi
- Revue 58. Rouge explicite
- Revue 57. L'imaginaire des technologies
- Revue 56. Nouveaux centres
- Revue 55. King Kong au pays du jeu vidéo
- Revue 54. Corps multiples
- Revue 51/52/53. Dans les bras du fleuve
- Revue 50. Villes horizons
- Revue 49. Design calin
- Anciens numéros

PATAUT. Entretien 4. Auteur
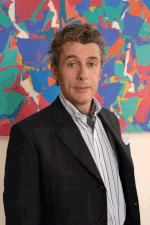
Si l'auteur crée des effets de narration, dans quelle mesure le lecteur est libre? Un rare entretien où le créateur parle avec esprit de finesse de la liberté de sa créature.
accompagné par Franck Senaud

F. S.
Te retrouves-tu dans chacun de ces textes? Si oui, comment?
F. P.
Inévitablement. Parce que je tire les ficelles à chaque fois.
F. S.
Tu veux dire que c’est l’art de manipuler le lecteur qui sert de fil conducteur à ton travail? Ou, tout au moins, que tu penses à un effet produit sur ce lecteur?
F. P.
Non. Je tire des ficelles au sens où je propose des fausses pistes, où j’indique des développements possibles qui resteront lettre muette, où la réalité qui s’offre au lecteur est toujours ambigüe.
Dans « Brahms BWV 1016 », par exemple, et dans « Harper’s Bazaar », la chute est différée. Plusieurs issues sont possibles jusqu’à la dernière page. Ce n’est pas tant que leur chute est inattendue. C’est qu’elle aurait pu être différente. Et puis il y aussi la question du dévoilement discret. Dans « Vidéos », par exemple, un passage très court — une seule phrase — suggère que les activités professionnelles de Scott sont liées à l’enlèvement de son fils. Si c’est bien le cas, la nouvelle prend un sens très différent de celui qu’elle a si l’on en reste à la lente descente aux Enfers de Bernie. Mais l’idée que cette descente est manipulée de l’intérieur du couple n’est rien de plus qu’une suggestion.
S’il le désire, le lecteur peut développer pour lui-même ce branchement possible de l’histoire.

Quant à l’effet produit sur le lecteur, c’est une chose extrêmement incertaine, très difficile à prévoir et à maîtriser.
On m’a fait part de réactions, à la lecture de telle ou telle nouvelle, que j’ai trouvées parfois très curieuses, qui me semblaient même aller à l’encontre du contenu de l’histoire. Mais je ne crois pas que la bonne explication soit que le lecteur n’avait pas compris ce qu’il lisait, ou qu’il avait interprété fautivement ce que l’auteur avait écrit. C’est quelque chose qui vient de l’intérieur du récit. C’est que l’histoire racontée est fixe jusqu’à un certain point. Il reste un élément de souplesse et même d’élasticité qui est, je crois, fonction du style ou du registre. Il y a plus de souplesse dans la parabole que dans la légende, plus d’élasticité, par exemple dans « Diaboliques » et dans « Allers-retours hésitants sur le pont Alexandre-III bien après le temps de l’Occupation », que dans « Légende du cercueil de verre ». Pour prendre un cas à l’extrême opposé, il y a indénibalement une pérennité en jeu dans « Les fourreurs ».
La raison est simple : le Temps a fait son œuvre. Le passé s’est figé. Le travail du lecteur est alors tout autre. C’est un travail de l’imagination qui dépend entièrement de sa sensibilité, de son sens du chagrin et de la tristesse.
F. S.
Comment contrôles-tu cette fixité de l’histoire? Est-ce quelque chose que tu sens? Crées-tu un point fixe au-delà duquel la souplesse ou l’élasticité reprennent leur droit? Cela est-il même possible?
F. P.
Il n’y a pas de contrôle absolu. Ce ne serait d’ailleurs pas souhaitable. Il n’y a pas de point fixe, mais simplement des éléments qui ne peuvent varier sans que l’histoire change d’identité et devienne tout simplement une autre histoire. Prenons par exemple la première nouvelle du recueil, « Kipling la nuit ». On ignore presque tout des deux filles de Madame Froy. En savoir plus sur elles ne ferait pas avancer l’histoire. Pour cette raison, il ne me semble pas que le lecteur désire en savoir plus, et la chute suggère très fortement qu’il ne le faut pas. En ce sens, l’histoire est fixe.
À l’opposé, « Heureux dénouement » est parfaitement élastique. On peut imaginer de soi-même la situation familiale très rapidement esquissée: le mariage de l’oncle et de la tante, à quoi ressemble le premier étage où la femme légitime se réfugie pour tenir les comptes et, bien sûr, l’identité véritable du narrateur. Ce qui importe est que lecteur — pas moi — ressente cette possibilité, cette souplesse ou cette ouverture. De mon côté, je les contrôle jusqu’à un certain point. L’histoire, en tout état de cause, est conçue pour que lecteur ait cette liberté.

F. S.
En tant qu’auteur qui se lit et se relit, comment vois-tu ou sens-tu ce point fixe?
F. P.
Il n’y a a priori aucun lien particulier entre le fait de se lire ou de se relire et le fait de déterminer à partir de quel moment la fixité de l’histoire s’affaiblit et laisse une certaine liberté d’imagination au lecteur. Il y a là, je crois, une grand part de jeu.
En un sens — et nous parlons bien évidemment du cas des nouvelles — c’est au lecteur d’imaginer une suite, une piste différente ou un dénouement contraire à celui voulu par l’auteur. Là encore, le style et le genre littéraire y sont pour beaucoup.
C’est le lecteur qui doit sentir, par exemple dans la parabole ou la fable, où sa liberté commence ; et si les choses se mettent correctement en place, ce travail intuitif se fait tout seul. Chacun, je crois, a fait l’expérience d’une lecture par laquelle une histoire s’impose de manière très stricte et disciplinée dans son déroulement, et également l'expérience inverse d’une lecture où la contrainte est moindre. Dans ce deuxième cas, et en particulier s’il apparaît au lecteur, au fur et à mesure qu’il avance, qu’il est de moins en moins dirigé, celui-ci ressent une certaine gêne. Il doit pallier à des manques, inventer, diriger à son tour les opérations.

F. S.
J’aimerais revenir sur ta formule « nettoyage incessant du langage ». Que signifie-t-elle? Indique-t-elle un but, un moyen?
F. P.
Elle renvoie ni plus ni moins au nettoyage incessant du langage qui me préoccupe lorsque j’écris une nouvelle.
J’ai généralement en tête une phrase isolée, la chute d’une histoire à écrire. Tout le problème est de savoir comment conduire le lecteur à cette chute. De manière inattendue ou au contraire comme si la fin était une conséquence inéluctable des premières phrases? Le nettoyage commence dès qu’une deuxième phrase fait surface. Il faut éliminer les impuretés, les fausses routes, les erreurs de style.
Une phrase — certains contextes très particuliers mis à part — n’est jamais seule, et le mauvais voisinage est l’une des pires choses qui soient. Le style, évidemment, contrairement à ce que dit le dictionnaire, n’est pas une manière particulière d’exprimer ses pensées, une façon qu’on pourrait faire varier comme on change de chapeau, mais plutôt une détermination à agir, une détermination du genre farouche, qui ne doit jamais fléchir, à donner une unité à un ensemble. Les phrases — et plus encore les phrases d’une nouvelle — doivent être dans un rapport étroit de consanguinité.
Il est question d’une machine à nettoyer la poésie dans « Machine (ou casque) », le premier texte de Rue Raynouard. C’est parce que la poésie est elle aussi pleine de saletés, de scories et de chausse-trapes. À chaque étape de la purification, il reste des résidus.
Toute la difficulté est de transformer ces résidus en détritus — au sens strict du terme: en fragments minuscules qu’il est désormais impossible d’utiliser et qu’on doit vouer au néant. Pour finir, vous devez obtenir une adhérence des phrases. C’est quelque chose de tout à fait différent de la cohérence ou de la simple contiguïté. Rien n’est plus affreux que l’effet de collage.
F. S.
Es-tu le même selon que tu écrives des nouvelles, des romans, de la poésie ou de la philosophie?
F. P.
Non. Dans le cas de la philosophie, je m’engage dans des débats déjà existants et je tente d’argumenter en faveur d’une solution.
Dans le cas de la littérature, je m’engage dans une création qui, bien qu’elle ne soit pas ex nihilo, est tributaire du travail des autres dans une bien moindre mesure. Ce n’est pas que les traditions soient moins fortes ou moins contraignantes dans le domaine de la fiction et de la poésie qu’elles le sont en philosophie. C’est plutôt qu’en philosophie, la rupture avec la tradition vous conduit très souvent à redéfinir les anciens problèmes, alors que si vous rompez avec le théâtre classique, ou la poésie symboliste, ou la nouvelle romantique, vous n’allez pas dire dans le langage du théâtre de l’absurde ce que Racine a dit autrement dans le langage épuré de la tragédie, ou faire du Mallarmé surréaliste, ou reprendre Novalis sous l’angle du réalisme social.

Le fait, par exemple, qu’une question philosophique disparaisse ne signifie pas qu’elle se soit volatilisée par magie, mais plutôt que nous ne pouvons plus l’exprimer comme nous l’exprimions auparavant. Les dilemmes philosophiques sont traîtres. Vous pensiez leur avoir claqué la porte au nez et voilà qu’ils reviennent par la fenêtre sans prévenir.
Dans le cas de la littérature, il y a la question du style. Non pas la question de la voix d’un auteur (le genre de chose qui trahit — quelle horreur — un talent) mais ce qui fait que vous ne pouvez ni l’imiter sans tomber dans le ridicule, ni déceler avec exactitude ce qui fait que vous êtes sous son emprise.
Il y a là, je crois, dans la facture même de la fiction, quelque chose de très anti-philosophique, au sens où vous n’êtes pas du tout face aux questions que la raison se pose à elle-même, mais face à vos limitations personnelles, et que surmonter ces limitations est un travail en tout point différent de celui qui consiste à proposer une solution originale à un dilemme, à un paradoxe, ou à une difficulté philosophique.
En bref, je ne suis pas le même dans les deux cas, et passer de la fiction à l’argumentation, souvent — eh bien, je ne sais vraiment pas comment le dire autrement — me fatigue.

